Je pense qu'il y a méprise, il n'est pas question de rapport public/joueur mais plutôt d'une critique du modèle libéral que l'on peut observer à travers le football de nos jours, et dont l'arrêt Bosman en est l'élément déclencheur (le billet de Stand en atteste viewtopic.php?f=759&t=52950#p1575560).
Pour revenir dessus, la fin des restrictions limitant le nombre de joueurs étrangers ressortissants UE fait que le joueur (jouissant dorénavant d'une mobilité internationale) est devenu une marchandise, accélérant de ce fait, le phénomène d'individualisation. L’intérêt du club est secondaire et chacun joue pour sa pomme, soigne ses statistiques et cherche à se démarquer, à sortir du lot, pour se vendre aux plus offrants en fin de saison et gonfler son compte en banque. Les Molde, Belgrade ou PSV champion d'europe, c'est de l'époque ancienne, révolue; aujourd'hui, seules les puissances financières, brassant du fric et pillant les "petites" équipes de leurs meilleurs joueurs font la loi, voici l’avènement du foot-business, et il ne faut pas s'y tromper, le public n'est qu'un consommateur, assujettis à des pirouettes marketing, et comme tout consommateur, râleur quand il juge que le service n'est pas conforme à ses attentes.
Pour revenir sur Tapie, je comprends que l'on puisse trouver hypocrite de s'offusquer en pointant du doigts un acteur pourri du système quand on éprouve aucune gène vis à vis du système en lui même, encore plus enclin à soulever le cœur, n’empêche qu'y trouver une forme de légitimité, c'est quand même limite......
| Annonces |
|---|
|
Bienvenue sur Funny Stadium !
Si les championnats amicaux sont lancés, des coupes amicales sont également proposées. Si vous souhaitez organiser une compétition, nous vous recommandons vous adresser à loocky911 |
[Ligue 1] - Olympique de Marseille
Modérateur: Lord casa
Re: [Ligue 1] - Olympique de Marseille
Dernière édition par neal512 le Mar Mar 22, 2016 3:46 am, édité 2 fois.
-

neal512 - Forumiste

- Messages: 959
- Inscription: Dim Fév 17, 2013 17:08 pm
Re: [Ligue 1] - Olympique de Marseille
Si, je pense que c'est important de parler du public puisque si l'on peut critiquer ce qu'est devenu le football de nos jours, c'est par rapport à nos "valeurs" de supporters et ce qu'on juge éthique, ou pas. Et ma pensée, c'est qu'avec un public qui n'en possède lui-même aucune, de ces valeurs, je ne vois pas de quel droit il pourrait en réclamer. Du coup, ou est le problème éthique d'un joueur qui part d'une équipe vers son concurrent au dernier moment ? Son propre public ne se gênera pas pour le descendre à la première occasion 
1-) L'élite des membre a toujours raison
2-) Si l'élite des membres a tort, voir la règle 1
Supporter inconditionnel de la capitale, par tous les temps.
2-) Si l'élite des membres a tort, voir la règle 1
Supporter inconditionnel de la capitale, par tous les temps.
- SurfictFS
- L'Elite des membres

- Messages: 6537
- Inscription: Lun Déc 17, 2007 15:43 pm
- Localisation: Made in Paris
Re: [Ligue 1] - Olympique de Marseille
Il n'y a, en aucun cas, un problème d'éthique lors du transfert d'un joueur vers un autre club, loin de là. Il n'est pas question de s'offusquer qu'un employé ait changé d'entreprise!!!! et c'est sur ce point que je ne rejoins pas Stand by me, qui propose de limiter la circulation de joueurs entre clubs du même championnat, ce qui revient à aller chercher dans d'autres ligues, d'autres pays, des joueurs qui ne seraient pas, pour le coup, plus motivés de défendre les couleurs du club acquéreur.
Pour ce qui est du public, on risque d'aller sur un tout autre terrain que celui du sport.
Pour ce qui est du public, on risque d'aller sur un tout autre terrain que celui du sport.
-

neal512 - Forumiste

- Messages: 959
- Inscription: Dim Fév 17, 2013 17:08 pm
Re: [Ligue 1] - Olympique de Marseille
On est d'accord. Pour moi non plus ça ne pose pas de problème d'éthique, mais je répondais à Stand 
1-) L'élite des membre a toujours raison
2-) Si l'élite des membres a tort, voir la règle 1
Supporter inconditionnel de la capitale, par tous les temps.
2-) Si l'élite des membres a tort, voir la règle 1
Supporter inconditionnel de la capitale, par tous les temps.
- SurfictFS
- L'Elite des membres

- Messages: 6537
- Inscription: Lun Déc 17, 2007 15:43 pm
- Localisation: Made in Paris
Re: [Ligue 1] - Olympique de Marseille
Prendre la défense du public face aux écarts de conduite (légaux ou illégaux) des athlètes et dirigeants, s’interroger – comme dans d’autres domaines - sur les salaires élevés des protagonistes et le prix à payer pour assister à leurs prestations, relève aujourd’hui d’un impardonnable populisme, d’une insupportable tendance à prendre parti pour ces masses dégénérées de consommateurs fanatiques et incultes, comme SurfictFS vient de nous le laisser entendre. C’est malheureusement vouloir confondre le peuple avec ce qu’il n’est pas : la populace - confusion quotidiennement entretenue par les curseurs de la bien-pensance, de Canal+ à l’Express en passant par France Inter...
« Le public d’aujourd’hui ne veut que de la performance, de la gagne, et même du beau jeu »
Ces considérations font échos à une critique du sport moderne faite par Huizinga (homo ludens) : le culte de la victoire transformerait les joueurs en sauvages et les spectateurs en fanatiques ; les masses passives rechercheraient la distraction banale en prenant le sport trop au sérieux, et inversement, le travail comme un jeu. Ce n’est pas parce qu’une partie du public contemporain, du fait de la transformation du sport en spectacle divertissant, se comporte comme des consommateurs incompréhensifs que les athlètes ont la légitimité à se dédouaner d’une certaine finesse, d’une certaine élégance dans leur comportement.
Car le public a toujours existé, il est même indissociable du fait sportif. Lorsqu’on parvient à atteindre une compétence, on a immanquablement envie de la montrer. A haut degré de maîtrise, l’exécutant ne désire plus seulement prouver sa virtuosité mais établir entre son public et lui une même appréciation d’un rituel exécuté à la perfection. La parade et la représentation sont un élément central : les joueurs exécutent une cérémonie familière qui réaffirme des valeurs communes. Cette cérémonie a besoin de témoins, des fans enthousiastes connaissant les règles et significations sous-jacentes. Les compétitions perdraient une immense partie de leur signification sans le rôle du public : c’est ainsi que jouer à huis clos est le résultat d’une sanction. A l’inverse du public des arts contemporains, le public sportif montre plus de discernement à définir les normes qui définissent la beauté et l’excellence d’une prestation, sans doute parce qu'il est constitué en grande majorité d’hommes ayant pratiqué dans leur jeunesse, et ainsi développé un sens du jeu en sachant distinguer ses différents degrés de qualité.
En revanche, vouloir attirer un public toujours plus nombreux et éclectique (jeunes enfants, femmes, non-inités qu’on invite au stade comme on remplit les salles de cinéma) tend à faire baisser le niveau de compréhension (d’où le flot interminable d’explications de la part des commentateurs sur les règles ou subtilités de tel dispositif). On transforme un sport et un art en numéro de cirque, au gré des conditions favorables à leur diffusion télévisée (horaires, météo...). Les spectateurs non avertis, traités comme tels, recherchent avant tout les sensations fortes, ce qui arrive dans les villes où une discipline est développée de manière artificielle, comme le hockey sur glace dans certaines villes du sud des États-Unis.
Une performance athlétique provoque un riche courant d’associations et de fantasmes : comme l’écrit Christopher Lasch, « être spectateur n’est pas plus passif que la rêverie, à condition que la prestation soit d’une qualité suffisante pour provoquer une réaction émotionnelle ». Aussi, gagner n’est pas le plus important, c’est la seule chose qui compte (George Allen) représente la dernière défense de l’esprit d’équipe contre sa détérioration. L’intrusion du marché dans la sphère sportive recréé les antagonismes de la société capitaliste, à travers les luttes à couteaux tirés entre organisations sportives, c’est pourquoi « aujourd’hui les gens associent la rivalité à l’agression sans frein ; il leur est difficile de concevoir une situation de compétition qui ne conduise pas directement à des pensées de meurtres ». Identifier le spectateur à la passivité et déplorer la compétition, c’est réduire le sport à un fade régime d’exercice physique salutaire (bonne santé, motivation et dynamisme qui font bien sur un CV), en éliminant toute la fantaisie du jeu. Le jeu oblitère la conscience de la vie quotidienne en exigeant de la part du joueur une certaine concentration pour un but inutile, selon des règles admises par tous ; lorsqu’ils se soumettent aux règles et aux conventions, joueurs et spectateurs coopèrent pour créer une illusion de la réalité, une représentation de la vie dans laquelle chaque participant endosse un rôle comme au théâtre.
Mais lorsqu’on ne prend pas le jeu suffisamment au sérieux pour respecter les conventions, on sape l’illusion et on brise l’enchantement. Or, le propre du libéralisme, c’est la transgression. Les commentateurs sont encouragés à adopter le style des amuseurs professionnels ; l’invasion du sport par l’éthique du divertissement brise les barrières séparant le rituel du jeu de la réalité sordide qu’il a pour mission de faire oublier. Lorsque la spontanéité disparaît du sport, celui-ci n’est plus en mesure d’inspirer joueurs et spectateurs ; la prudence et le calcul gouvernent le sport comme tout le reste (rappelons à ce propos que le PSG n’a perdu aucun match au Parc des Princes de mai 2014 à mars 2016, montrant bien la part d’aléatoire dans le « principe du football » contemporain ).
).
La colère angoissée du simple admirateur face aux dégradations par l'industrie du divertissement est donc parfaitement légitime, mais si elle occasionne des débordements de violence exacerbée, c'est d'abord le fait de règles de tenue et de fair-play transgressées ; transgressions dont le public n'est pas le premier responsable.
Pour répondre à Neal512, je citerai encore une fois Christopher Lasch :
On ne s'étonnera pas que les équipes de Ligue 1 jouent alors avant tout pour ne pas perdre avant de vouloir gagner. Personne n'a envie de vivre le destin du RC Strasbourg...
Enfin, j'espère que vous prendrez du plaisir à admirer les prestations des "employés" de la sélection qatari lors du mondial 2022. Vos conceptions des valeurs sportives et de l'éthique en général n'en seront que renforcées.
« Le public d’aujourd’hui ne veut que de la performance, de la gagne, et même du beau jeu »
Ces considérations font échos à une critique du sport moderne faite par Huizinga (homo ludens) : le culte de la victoire transformerait les joueurs en sauvages et les spectateurs en fanatiques ; les masses passives rechercheraient la distraction banale en prenant le sport trop au sérieux, et inversement, le travail comme un jeu. Ce n’est pas parce qu’une partie du public contemporain, du fait de la transformation du sport en spectacle divertissant, se comporte comme des consommateurs incompréhensifs que les athlètes ont la légitimité à se dédouaner d’une certaine finesse, d’une certaine élégance dans leur comportement.
Car le public a toujours existé, il est même indissociable du fait sportif. Lorsqu’on parvient à atteindre une compétence, on a immanquablement envie de la montrer. A haut degré de maîtrise, l’exécutant ne désire plus seulement prouver sa virtuosité mais établir entre son public et lui une même appréciation d’un rituel exécuté à la perfection. La parade et la représentation sont un élément central : les joueurs exécutent une cérémonie familière qui réaffirme des valeurs communes. Cette cérémonie a besoin de témoins, des fans enthousiastes connaissant les règles et significations sous-jacentes. Les compétitions perdraient une immense partie de leur signification sans le rôle du public : c’est ainsi que jouer à huis clos est le résultat d’une sanction. A l’inverse du public des arts contemporains, le public sportif montre plus de discernement à définir les normes qui définissent la beauté et l’excellence d’une prestation, sans doute parce qu'il est constitué en grande majorité d’hommes ayant pratiqué dans leur jeunesse, et ainsi développé un sens du jeu en sachant distinguer ses différents degrés de qualité.
En revanche, vouloir attirer un public toujours plus nombreux et éclectique (jeunes enfants, femmes, non-inités qu’on invite au stade comme on remplit les salles de cinéma) tend à faire baisser le niveau de compréhension (d’où le flot interminable d’explications de la part des commentateurs sur les règles ou subtilités de tel dispositif). On transforme un sport et un art en numéro de cirque, au gré des conditions favorables à leur diffusion télévisée (horaires, météo...). Les spectateurs non avertis, traités comme tels, recherchent avant tout les sensations fortes, ce qui arrive dans les villes où une discipline est développée de manière artificielle, comme le hockey sur glace dans certaines villes du sud des États-Unis.
Une performance athlétique provoque un riche courant d’associations et de fantasmes : comme l’écrit Christopher Lasch, « être spectateur n’est pas plus passif que la rêverie, à condition que la prestation soit d’une qualité suffisante pour provoquer une réaction émotionnelle ». Aussi, gagner n’est pas le plus important, c’est la seule chose qui compte (George Allen) représente la dernière défense de l’esprit d’équipe contre sa détérioration. L’intrusion du marché dans la sphère sportive recréé les antagonismes de la société capitaliste, à travers les luttes à couteaux tirés entre organisations sportives, c’est pourquoi « aujourd’hui les gens associent la rivalité à l’agression sans frein ; il leur est difficile de concevoir une situation de compétition qui ne conduise pas directement à des pensées de meurtres ». Identifier le spectateur à la passivité et déplorer la compétition, c’est réduire le sport à un fade régime d’exercice physique salutaire (bonne santé, motivation et dynamisme qui font bien sur un CV), en éliminant toute la fantaisie du jeu. Le jeu oblitère la conscience de la vie quotidienne en exigeant de la part du joueur une certaine concentration pour un but inutile, selon des règles admises par tous ; lorsqu’ils se soumettent aux règles et aux conventions, joueurs et spectateurs coopèrent pour créer une illusion de la réalité, une représentation de la vie dans laquelle chaque participant endosse un rôle comme au théâtre.
Mais lorsqu’on ne prend pas le jeu suffisamment au sérieux pour respecter les conventions, on sape l’illusion et on brise l’enchantement. Or, le propre du libéralisme, c’est la transgression. Les commentateurs sont encouragés à adopter le style des amuseurs professionnels ; l’invasion du sport par l’éthique du divertissement brise les barrières séparant le rituel du jeu de la réalité sordide qu’il a pour mission de faire oublier. Lorsque la spontanéité disparaît du sport, celui-ci n’est plus en mesure d’inspirer joueurs et spectateurs ; la prudence et le calcul gouvernent le sport comme tout le reste (rappelons à ce propos que le PSG n’a perdu aucun match au Parc des Princes de mai 2014 à mars 2016, montrant bien la part d’aléatoire dans le « principe du football » contemporain
La colère angoissée du simple admirateur face aux dégradations par l'industrie du divertissement est donc parfaitement légitime, mais si elle occasionne des débordements de violence exacerbée, c'est d'abord le fait de règles de tenue et de fair-play transgressées ; transgressions dont le public n'est pas le premier responsable.
Pour répondre à Neal512, je citerai encore une fois Christopher Lasch :
Invité a écrit:Les tentatives pour créer un domaine séparé du jeu pur, totalement isolé du monde du travail, ont donné naissance à son opposé. C’est ainsi que, suivant la formulation qu’en donne Cosell, on a insisté pour que « le sport ne soit pas tenu isolé et séparé de la vie, un « pays des merveilles » particulier où tout est pur et sacré, et au-dessus de tout soupçon » ; on a demandé qu’il soit considéré comme une entreprise comme n’importe quelle autre, soumis aux mêmes critères et aux mêmes examens. (...) Ce qui avait commencé comme une volonté de conférer au sport une signification religieuse, et même d’en faire un substitut de plein droit de la religion, aboutit à sa démythification et à son assimilation au monde du divertissement.
On ne s'étonnera pas que les équipes de Ligue 1 jouent alors avant tout pour ne pas perdre avant de vouloir gagner. Personne n'a envie de vivre le destin du RC Strasbourg...
Enfin, j'espère que vous prendrez du plaisir à admirer les prestations des "employés" de la sélection qatari lors du mondial 2022. Vos conceptions des valeurs sportives et de l'éthique en général n'en seront que renforcées.
-

stand by me - Forumiste

- Messages: 2036
- Inscription: Lun Mai 17, 2010 16:19 pm
- Localisation: très précise, merci google
Re: [Ligue 1] - Olympique de Marseille
Tout à fait.
Lord casa est une légende sur FS... mais pas sur Défifoot !
RACING - Balonny CONF 1 : Championnat français
FC VAUGAREAU - Cornerra CONF 3
HOLSTEIN KIEL - Galand CONF 4 : Championnat anglais, écossais & Superleague
CELTIC GLASGOW - Hoolantine CONF 8
RACING - Balonny CONF 1 : Championnat français
FC VAUGAREAU - Cornerra CONF 3
HOLSTEIN KIEL - Galand CONF 4 : Championnat anglais, écossais & Superleague
CELTIC GLASGOW - Hoolantine CONF 8
-

Lord casa - Modérateur FS

- Messages: 14010
- Inscription: Ven Nov 10, 2006 11:08 am
- Localisation: INDRE ET LOIRE
Re: [Ligue 1] - Olympique de Marseille
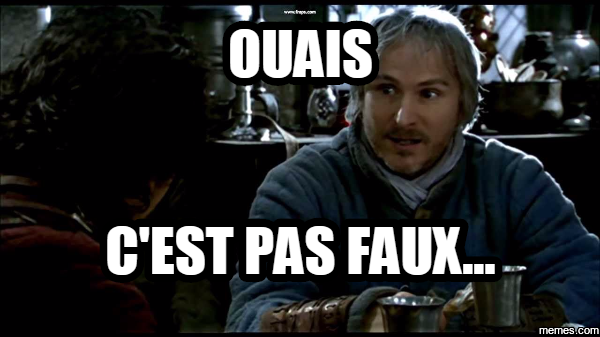
Ex Manager du RC Lens Legendary et du RC Lens Origins. Mon palmarès est le contraire de celui du Stade Rennais ces 40 dernières années.
-
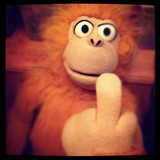
do-marcolino - L'Elite des membres

- Messages: 5052
- Inscription: Mar Juil 15, 2008 16:05 pm
- Localisation: Angers
Re: [Ligue 1] - Olympique de Marseille
J'ai oublié tes coloriages, do-marcelino. La prochaine fois j'y penserai.
-

stand by me - Forumiste

- Messages: 2036
- Inscription: Lun Mai 17, 2010 16:19 pm
- Localisation: très précise, merci google
Re: [Ligue 1] - Olympique de Marseille
Racing qui est en bonne voie pour remonter en Ligue 2
beau jeu, fair-play et buts, c'est ma devise
Manager pro de Kyoka Suigetsu

Manager pro de Kyoka Suigetsu

-

bedal - Forumiste

- Messages: 2510
- Inscription: Jeu Oct 03, 2013 19:39 pm
Re: [Ligue 1] - Olympique de Marseille
stand by me a écrit:J'ai oublié tes coloriages, do-marcelino. La prochaine fois j'y penserai.
C'est un o, pas un e. Je te ferais un dessin également si ça rentre pas, a la longue.
Ex Manager du RC Lens Legendary et du RC Lens Origins. Mon palmarès est le contraire de celui du Stade Rennais ces 40 dernières années.
-
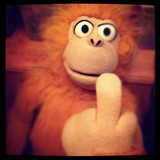
do-marcolino - L'Elite des membres

- Messages: 5052
- Inscription: Mar Juil 15, 2008 16:05 pm
- Localisation: Angers
Retourner vers Football français
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités
