Bien. Cela commence à faire un bout de temps que je ne l’ai pas ramenée sur ce forum, alors puisque l’occasion m’est présentée d’apporter du grain à moudre, foi de spécialiste, je ne vais pas me priver !

Inutile de reprendre les six points les uns après les autres, une seule réponse synthétique vaut mieux que cinq avis en pièces détachées. Comme ça, on saisit mieux la mécanique d’ensemble. Activité intellectuellement stimulante et culturellement enrichissante que l’analyse rationnelle par le recoupements d’informations, en notre époque (im)médiatique de l’hystérico-émotionnel instantané. Je le recommande vivement.

Parenthèse fermée.
Comme l’a proposé
Jakomano, parlons dans la bonne humeur du football professionnel et de ceux qui le pratiquent. D’abord, un constat, indéniable : il y a les clubs riches, avec de bons joueurs, qui gagnent facilement (PSG, point 1), et d’autres malheureusement moins bien lotis qui ne gagnent jamais (TFC, point 2). Mais, chose étrange, ces gros clubs ne gagnent pas de manière systématique (indice UEFA, point 4), pire, les meilleures écuries européennes ne sont même pas à l’abri de contre-performances (Chelsea, point 5) ! Les joueurs, eux, lorsqu’ils ne donnent pas l’impression d’être les membres d’un univers franchement crapuleux (sextape, point 3), se font remarquer par leur maladresse (Andreasen, point 6). Alala... tous ceux qui ont grandi en ces temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître peuvent le dire : c’était mieux avant !
Lord Casa l’a d’ailleurs fort justement souligné :
Lord casa a écrit:Il y a 20 ans, on voyait Nantes en demi-finale de Champions League contre la Juve, le PSG remporter la C2 et Bordeaux s'écrouler en finale de la Coupe UEFA contre la Bayern. A l'époque, le fric ne dominait pas tant que ça, seul le champion (voire son dauphin de championnat) participait à la C1 et les 3e/4e/5e jouaient en C3. La coupe UEFA était bien plus intéressante bien que pas assez lucrative. Strasbourg battait Liverpool, Guingamp faisait 0-0 a San Siro contre l'Inter, Metz et Lens pouvait taper Newcastle, le Sporting et compagnie...aujourd'hui, Monaco galère contre un club azéri, l'OM tremble et perd contre un club slovaque, Bordeaux n'a pas gagné de match dans un groupe qui comporte Sion (Suisse) et un club modeste russe... bref, c'est un peu de n'importe quoi.
Exactement. C’est n’importe quoi... mais ça dépend dans quel sens on l’entend. Pour un Anglais en 1997, voir Strasbourg battre Liverpool était peut-être aussi n’importe quoi... Enfin, ce n’est pas la question, la réponse, elle, tient en six lettres, et il est étrange qu’aucun ne l’ait faite remarquer jusqu’ici : Bosman !
A une époque où le fric ne dominait pas tant que ça (sinon qu’un homme d’affaires aux pratiques douteuses pouvait mener un club français vers les sommets européens en payant les meilleurs joueurs
et les adversaires...), à une époque où la France était la deuxième nation UEFA,
la fédération européenne maintenait une limitation (à trois individus) du nombre de joueurs étrangers dans l’effectif des clubs.
L’arrêt Bosman de décembre 1995, né du transfert capoté de Jean-Marc Bosman de Liège vers Dunkerque, prévoit l’abolition de cette limitation. En effet, celle-ci est désormais considérée comme contraire au Traité de Rome stipulant la libre-circulation de la marchandise humaine au sein de la communauté européenne. En politiquement correct, il s’agit de « motifs de discrimination communautaire » (i.e préférence nationale, sport national suisse).
Véritable révolution copernicienne, l’arrêt Bosman constitue selon moi l’instant initial, le Big Bang qui créa l’univers du football post-moderne tel qu’on le connaît aujourd’hui. Jusqu’au milieu des années 1990, pour être compétitif il fallait penser niveau national, donc privilégier la formation aux transferts exotiques. Ce n’est d’ailleurs pas par hasard que l’équipe de France s’est distinguée en 1998 et 2000, avec sur le terrain des marseillais, des monégasques, des auxerrois, d'anciens nantais, lensois... avant de plonger ensuite dans les errances que nous connaissons aujourd’hui, les «
problèmes d’égo » dixit Emmanuel Petit (exception faite du mondial 2006 où la sélection fut portée par un Zidane hors normes). L’arrêt Bosman n’est qu’un fragment de ce que représente le projet européen dans son ensemble et depuis sa fondation : l’ouverture socio-économique, l’effondrement de ce qui peut substituer de spécificités locales, devenant par là même les proies des affairistes les plus voraces ; bref, la loi de la jungle (celle de Tarzan, pas celle de Calais) instituée. C’est ainsi qu’en 2000, Chelsea fut le premier club à aligner 11 joueurs non britanniques en Premier League, le cosmopolitisme du capital allant de pair avec le cosmopolitisme des individus. Les zones les plus avantagées économiquement et juridiquement ont su tirer leur épingle du jeu, et nous voilà dans la situation actuelle.
Revenons vers
Lord Casa :
Lord casa a écrit:Bref, notre championnat n'est pas intéressant simplement parce que l'argent n'y circule pas en masse. La Russie nous rattrape parce que son championnat devient très lucratif, les joueurs sont bien payés et sont parmi les dernières à se faire éliminer au printemps. Quand on voit qu'en France, seul Guingamp nous a représenté correctement en C3, on se dit peut-être que les français devraient arrêter de se regarder les pieds et de jouer la Coupe d'Europe correctement au lieu de se plaindre de jouer le jeudi et le dimanche. Je n'entends pas les clubs allemands, italiens, anglais et espagnol se plaindre de jouer intel le jeudi et le Real/Barça/Bayern/Juve/United/City le dimanche.
Donc, si je suis le raisonnement, il faudrait infliger au championnat français la fuite en avant libérale responsable de son déclin des 20 dernières années ? Et pourquoi pas vendre nos aéroports ou nos centrales nucléaires tant qu’on y est

... ah non, ça, c’est Macron qui s’en charge. Ou botter les fesses de ces fainéants de joueurs qui ne veulent pas jouer trois fois par semaine ? Il y a peut-être de ça... c’est à mon sens un peu plus compliqué.
Avant d’entrer plus en détails dans l’analyse de la relation joueur-club, écoutons Christopher Lasch, essayiste américain du XXème siècle, nous parler du déclin de l’esprit sportif dans son ouvrage
La Culture du Narcissisme de 1979 (donc bien avant les démesures du football européen, que lui-même n’a pas connues, décédé en 1994) :
Lasch a écrit:La banalisation de l’athlétisme
Ce qui corrompt le jeu ou le sport, ce n’est pas le professionnalisme ou la compétition, mais la désintégration des conventions qui s’y rapportent. C’est alors que le rituel, le théâtre et le sport dégénèrent tous en spectacle. (...)
Ce n’est donc pas parce qu’on le prend trop au sérieux que le sport se dégrade, mais parce qu’on le banalise. Le pouvoir du jeu vient de ce que l’on confère de l’importance à une activité qui n’en a apparemment pas. (...) L’imaginaire et la fantaisie mettent nos contemporains mal à l’aise, et il semble que nous soyons résolus à détruire les innocents plaisirs de remplacement qui, jadis, charmaient et consolaient. Dans le cas du sport, joueurs, promoteurs, spectateurs, tous s’acharnent contre l’illusion. Les premiers nient le sérieux du sport ; ils veulent être considérés comme des gens qui distraient le public (en partie pour justifier leurs salaires considérables). Les promoteurs encouragent le public à devenir fanatiques, même dans des sports comme le tennis, où traditionnellement régnait une certaine tenue. La télévision a créé une nouvelle catégorie de spectateurs et transformé ceux qui assistent à la rencontre en participants, qui cherchent à se mettre dans le champ de la caméra et à attirer l’attention en gesticulant ou en agitant des drapeaux.
Bureaucratie et « travail en équipe »
Le mode prédominant d’interaction sociale est, de nos jours, la coopération antagoniste, selon les termes de David Riesman dans La Foule Solitaire ; cela signifie que le culte du travail en équipe masque une lutte pour survivre à l’intérieur des organisations bureaucratiques. Dans le domaine du sport, la rivalité entre équipes, désormais incapables de faire appel aux loyautés régionales ou locales, se réduit à une lutte pour une part de marché, réplique des rivalités entre entreprises industrielles et commerciales.Le sportif professionnel se soucie peu que son équipe gagne ou perde (puisque les perdants touchent une partie des recettes) pourvu qu’elle continue à fonctionner.
Le professionnalisme dans le sport (...) a miné l’ancien « esprit d’école » et donné naissance, chez les athlètes, à une vision totalement mercantile de leur art. Ils écoutent avec un cynisme amusé les prêches des entraîneurs de l’ancienne école et n’acceptent pas volontiers une discipline autoritaire. Leurs changements fréquents, d’un club et d’une localité à l’autre, suivant les contrats qu’on leur offre, sapent la fidélité tant des joueurs que des spectateurs, et rendent difficile d’ancrer « l’esprit d’équipe » dans un patriotisme local. Dans une société bureaucratique, la fidélité à une organisation perd de sa force. Si les sportifs s’appliquent encore à subordonner leurs performances à celles de l’équipe, ce n’est pas parce que celle-ci, en tant qu’entité, transcende les intérêts individuels, mais simplement pour conserver des rapports harmonieux avec leurs collègues. Dans la mesure où il distrait les foules, le sportif cherche avant tout à promouvoir son propre intérêt, et vend ses services au plus offrant. Les meilleurs se transforment en célébrités ; ils deviennent alors des supports publicitaires et touchent des sommes qui dépassent souvent leurs salaires déjà élevés.
Que nous dit Christopher Lasch ?
1

la professionnalisation du domaine sportif, devenu un néo-show-business, a dilué le sérieux initial du sport (rituel avec le public, chauvinisme, opportunité diplomatique...) dont les sportifs se sentaient autrefois investis.
2

l’effondrement de ce sérieux, qui conférait au sport toute la fantaisie et l’imaginaire si caractéristique, entraîne chez les acteurs autant que chez les spectateurs la désillusion, un sentiment de ne pas être dupe, qui dégénère en cynisme désabusé.
3

ce cynisme explique d‘une part le comportement des foules, qui se plaisent à ne prendre parti pour aucun club ou formation de manière fidèle, mais à préférer la neutralité du beau geste, « le beau jeu » (comme Dugarry avant OM-PSG), donc à suivre avec détachement les organisations les mieux armées, i.e les plus riches ; d’autre part, celui des sportifs, indifférents au sort des équipes qu’ils sont censés représenter (d’où la petite phrase de Mendy après OM-Nice, ou le fait que Ribéry mette un terme précoce à son parcours en équipe de France)
4

le sportif n’est plus qu’un amuseur public qui travaille d’abord pour lui-même, entouré d’un ou plusieurs agents qui veillent à affuter son marketing personnel, il cherchera les opportunités les plus lucratives pour améliorer son image de marque avant d’estimer pouvoir partir en retraite.
Ces propos datant de 1979, on comprend alors à quel point l’arrêt Bosman constitue un cocktail explosif une quinzaine d’années plus tard... De manière générale, dans le milieu professionnel, les joueurs sont devenus des mercenaires (l’inverse des athlètes de la Grèce antique qui jouaient parfois leur vie), payés assez chers, non impliqués dans les performances du club, et ultra-mobiles (la fidélité des Totti, Pirlo, Rooney, tient du prodige). Le football professionnel est devenu un vivier de petits délinquants sans foi ni loi qui ont quitté l’école avant 14 ans et ne sauront rien faire d’autre de leurs vies (à part consultant pour ceux qui ont la tchatche et qui s’en sortent pas trop mal). Entre un Valbuena qui ne trouve vraiment rien de gênant de passer de Marseille à Lyon en une année, et
un Benzema qui fait chanter ses petits camarades, que nous reste-t-il ? Gourcuff ?... encore blessé !

Ainsi, il devient difficile, même avec de l’argent et un entraîneur de renom, de former une équipe de haut niveau. On le voit bien avec Monaco. Les clubs de milieu de tableau, peu attractifs sur la scène internationale, pris entre le marteau et l’enclume, sont forcés de mener une politique contre-productive (voire même absurde) qui consiste à payer très cher (en salaires) des joueurs qui savent très bien qu’ils n’auront ni la visibilité ni l’émulation caractéristiques des grands clubs, donc qui ont tendance à se laisser aller pour des résultats finalement médiocres.
C’est pourquoi
la problématique souvent évoquée des entraînements, censés être ardus à l’étranger et laxistes en France, est biaisée : il faut considérer l’interaction club-joueur. Un joueur sera plus respectueux des consignes si des enjeux personnels sont concernés.
Dans un grand club, le sportif devra jouer des coudes, sortir du lot, attacher son nom à des performances de haut niveau, pour gagner en visibilité. Il s’agit de paramètres non-quantitatifs (du moins, pas directement), et nous touchons ici à un paradoxe qui touche des clubs comme Chelsea, Manchester City, et à mon avis touchera le PSG un jour ou l’autre. Seuls les clubs ultra-prestigieux (comme Madrid) peuvent garantir à leurs joueurs cadres un rayonnement international sur plusieurs saisons : le joueur se donne à fond pour l'équipe, et réciproquement l'image de prestige du club vient s'associer au nom de l'athlète. En revanche, sans culture foot locale, sans passé glorieux et sans histoires légendaires à transmettre (cf. « notre histoire
deviendra légende »), bref, sans cette richesse qui ne s’achète pas, des clubs comme Chelsea peuvent dominer et réussir des performances européennes en se payant les meilleurs joueurs à coup de milliards, mais ne seront jamais à l’abri d’une démotivation générale dès lors que les athlètes « n’ont plus faim ».
Finalement, après la reprise fomentée par Nicolas Sarkozy du PSG par le Qatar, l’effet « aspiration vers le haut », ce leurre que tous les experts nous avaient promis il y a 3 ans, n’a évidemment pas eu lieu. Le club de la capitale est à sa place, Toulouse mal classé (mais ça aurait pu être Lorient, Bastia, Rennes ou Nantes, tant les clubs de L1 sont devenus interchangeables). A l’heure de la globalisation, du sport-spectacle et des dérégulations en tous genres, le temps où les nations pouvaient compter sur leurs jeunes pour briller semble révolu. Avoir un championnat à 22 ou 18 clubs ne changera pas grand-chose. Même le Brésil y a perdu son âme. Tout espoir est-il perdu ?... Libre à vous d’approuver... ou de zapper !






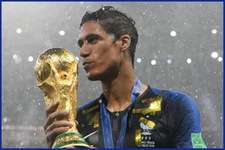







 Parenthèse fermée.
Parenthèse fermée.