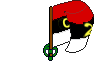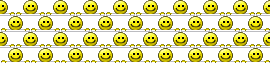Puisqu'on en parlait avec Kairnon dans le topic Musique, je suis en train de lire Maintenant qu'il fait tout le temps nuit sur toi de Mathias Malzieu, chanteur du groupe Dionysos.
Ce roman est vraiment un bol d'air, on est dans un autre monde, on oublie tout pour être transporté dans le monde farfelu et poétique de Mathias Malzieu. C'est un livre que je conseille.
Et dans le même genre, La mécanique du coeur est un roman qui vaut le coup à ce qu'il parrait, je le lirais après le premier cité. Ce dernier va notamment être fait en film par Luc Besson au cinéma en Février 2014 !
| Annonces |
|---|
|
Bienvenue sur Funny Stadium !
Si les championnats amicaux sont lancés, des coupes amicales sont également proposées. Si vous souhaitez organiser une compétition, nous vous recommandons vous adresser à loocky911 |
votre dernier bouquin
Modérateur: VySe
Re: votre dernier bouquin
♪♫ Ce matin, un lapin, a tué un chasseur ♪♫
Award de la Culture Cinématographique, de la Culture Musicale, et du Tandem de l'année 2011.
Award de l'Accueil et du Tandem 2012.
Présent sur le forum pendant deux jours, une année sur deux.
Je sais néanmoins faire des pâtes avec du gruyère rapé.
Award de la Culture Cinématographique, de la Culture Musicale, et du Tandem de l'année 2011.
Award de l'Accueil et du Tandem 2012.
Présent sur le forum pendant deux jours, une année sur deux.
Je sais néanmoins faire des pâtes avec du gruyère rapé.
-

tryo - Entraîneur

- Messages: 3499
- Inscription: Mer Oct 20, 2010 11:23 am
- Localisation: Avec Charlie.
Re: votre dernier bouquin
Je suis quasiment à la fin de "Maintenant qu'il fait tout le temps nuit sur toi" de Mathias Malzieu. Et je suis entièrement d'accord avec ce que dit Tryo ! Un roman magnifique, bien écrit où l'on voit bien que le chanteur du groupe Dionysos est retourné un peu en enfance. Un super roman original et poétique, en l'honneur de sa mère décédée. Un livre à lire absolument !
-

Kairnon - Entraîneur

- Messages: 3283
- Inscription: Mar Sep 23, 2008 18:47 pm
- Localisation: Gotham City
Re: votre dernier bouquin
Kairnon a écrit:Je suis quasiment à la fin de "Maintenant qu'il fait tout le temps nuit sur toi" de Mathias Malzieu. Et je suis entièrement d'accord avec ce que dit Tryo ! Un roman magnifique, bien écrit où l'on voit bien que le chanteur du groupe Dionysos est retourné un peu en enfance. Un super roman original et poétique, en l'honneur de sa mère décédée. Un livre à lire absolument !
Aaaaaah !
Je suis content que tu l'ai lu et qu'il t'ai plu !
Je te jure qu'en lisant ce bouquin, j'étais transporté dans son monde, ému par moments, c'est magnifique.
♪♫ Ce matin, un lapin, a tué un chasseur ♪♫
Award de la Culture Cinématographique, de la Culture Musicale, et du Tandem de l'année 2011.
Award de l'Accueil et du Tandem 2012.
Présent sur le forum pendant deux jours, une année sur deux.
Je sais néanmoins faire des pâtes avec du gruyère rapé.
Award de la Culture Cinématographique, de la Culture Musicale, et du Tandem de l'année 2011.
Award de l'Accueil et du Tandem 2012.
Présent sur le forum pendant deux jours, une année sur deux.
Je sais néanmoins faire des pâtes avec du gruyère rapé.
-

tryo - Entraîneur

- Messages: 3499
- Inscription: Mer Oct 20, 2010 11:23 am
- Localisation: Avec Charlie.
Re: votre dernier bouquin
Oui absolument ! Très émouvant, c'est bien le mot ! Il est assez extraordinaire ! L'écriture est plutôt simple, mais d'une efficacité remarquable !
Mathias Malzieu est un grand artiste, tant au niveau littéraire qu'au niveau musical avec Dionysos.
Mathias Malzieu est un grand artiste, tant au niveau littéraire qu'au niveau musical avec Dionysos.
-

Kairnon - Entraîneur

- Messages: 3283
- Inscription: Mar Sep 23, 2008 18:47 pm
- Localisation: Gotham City
Re: votre dernier bouquin
Et dire qu'on entend peu aprler de ce mec dans les médias... 
Des gens comme ça mérite d'être reconnu ! Ca nous change de Zaho, Sexion d'Assaut, et Musso quoi.
Des gens comme ça mérite d'être reconnu ! Ca nous change de Zaho, Sexion d'Assaut, et Musso quoi.
♪♫ Ce matin, un lapin, a tué un chasseur ♪♫
Award de la Culture Cinématographique, de la Culture Musicale, et du Tandem de l'année 2011.
Award de l'Accueil et du Tandem 2012.
Présent sur le forum pendant deux jours, une année sur deux.
Je sais néanmoins faire des pâtes avec du gruyère rapé.
Award de la Culture Cinématographique, de la Culture Musicale, et du Tandem de l'année 2011.
Award de l'Accueil et du Tandem 2012.
Présent sur le forum pendant deux jours, une année sur deux.
Je sais néanmoins faire des pâtes avec du gruyère rapé.
-

tryo - Entraîneur

- Messages: 3499
- Inscription: Mer Oct 20, 2010 11:23 am
- Localisation: Avec Charlie.
Re: votre dernier bouquin
C'est tout à fait ça Tryo ! 
-

Kairnon - Entraîneur

- Messages: 3283
- Inscription: Mar Sep 23, 2008 18:47 pm
- Localisation: Gotham City
Re: votre dernier bouquin
Je suis en train de lire "Sur la route" de Kerouac, roman sur la beat génération !
-

Kairnon - Entraîneur

- Messages: 3283
- Inscription: Mar Sep 23, 2008 18:47 pm
- Localisation: Gotham City
Re: votre dernier bouquin
cinquante nuance de grey , les trois livres.
J'ai trouver ca bien.
J'ai trouver ca bien.
Organisateur de compétitions amicales 2006-2020
- Sebastiien
- L'Elite des membres

- Messages: 20172
- Inscription: Lun Fév 23, 2009 14:45 pm
- Localisation: Belgique
Re: votre dernier bouquin
Bon... au risque de me faire éjecter...
J'aime bien relire quelques Tintin de temps en temps... et je pense que je vais m'y remettre avant la censure ultime.
http://www.lefigaro.fr/bd/2014/12/09/03014-20141209ARTFIG00360-raciste-antisemite-sexiste-tintin-sur-le-banc-des-accuses.php
Bonne nuit tout le monde !
J'aime bien relire quelques Tintin de temps en temps... et je pense que je vais m'y remettre avant la censure ultime.

http://www.lefigaro.fr/bd/2014/12/09/03014-20141209ARTFIG00360-raciste-antisemite-sexiste-tintin-sur-le-banc-des-accuses.php
Bonne nuit tout le monde !
-

stand by me - Forumiste

- Messages: 2036
- Inscription: Lun Mai 17, 2010 16:19 pm
- Localisation: très précise, merci google
Re: votre dernier bouquin
Pour qui, pourquoi travaillons-nous ?
Lois Macron, ubérisations, exaltation de la « valeur-travail », « France des assistés » contre « France qui se lève tôt », égalitarisme salarial contre discriminations... l’affligeante pauvreté du débat sur le travail, de la bouche des professionnels de la politique (tous partis confondus) ou des syndicalistes, occulte des questions de fond cruciales, dans une France qui se désindustrialise (mais c’est bien connu, les Français sont des feignasses, n’est-ce pas Mr Gattaz ?), et plus globalement dans un monde en passe de connaître des années de crise majeure. Quand on n’a que « croissance » et « progrès » comme conception du bien commun, il ne faut pas s’étonner de s’enfoncer dans des impasses. C’est pourquoi je recommande vivement ce recueil de 8 articles de Jacques Ellul, qui a le mérite de remettre les points sur les i et les barres sur les T.
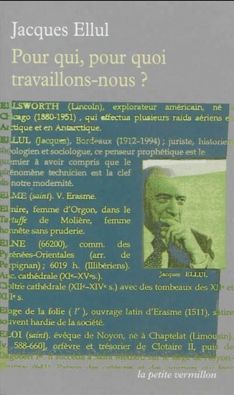
L’auteur y démonte un lieu commun très en vogue aujourd’hui, reprise des Lumières : « le travail rend libre ». Or, traditionnellement, le travail est une contrainte, une corvée qu’on cherche à déléguer ; nombreuses sont les civilisations à avoir voué une certaine défiance envers ces tâches, pour un modèle de société plus sobre et moins gourmand en ressources naturelles. C’est à partir du 18ème siècle et l’émergence de l’idéologie bourgeoise que le travail est devenu vertu ; l’Église, par abdication, s’y est alignée, travestissant par là le message biblique ; suivie des marxistes, menant le prolétariat dans une impasse ; et enfin, de tout le logiciel moderne actuel, qu’il soit progressiste ou conservateur. Si la paresse est un vice, l’idéologie du travail, nouvel opium du peuple, induit une certaine répugnance envers le temps libre, tandis que les progrès techniques qu’elle permet conduisent fatalement à des réductions du temps de travail humain et à des mutations de celui-ci. Si le travail, conduisant à l’idolâtrie, est une aliénation, son automatisation mène au chômage qui l’est davantage.
Face à ces constats, le programme reste utopique : redéfinir le concept de salaire, « vers un travail ayant une productivité faible et une consommation de main d'œuvre forte », « une frugalité assumée en commun » ; un objectif qui implique une lutte à mort contre les classes au pouvoir, les classes des possédants, donneuses de leçons, sûres d’elles-mêmes et dominatrices. Finalement, seules la foi et la vocation au service du bien commun viennent compenser un travail vain et vide de sens.
Des concepts fondamentaux que nos maîtres se garderont bien d’évoquer...
Face à ces constats, le programme reste utopique : redéfinir le concept de salaire, « vers un travail ayant une productivité faible et une consommation de main d'œuvre forte », « une frugalité assumée en commun » ; un objectif qui implique une lutte à mort contre les classes au pouvoir, les classes des possédants, donneuses de leçons, sûres d’elles-mêmes et dominatrices. Finalement, seules la foi et la vocation au service du bien commun viennent compenser un travail vain et vide de sens.
Des concepts fondamentaux que nos maîtres se garderont bien d’évoquer...
-

stand by me - Forumiste

- Messages: 2036
- Inscription: Lun Mai 17, 2010 16:19 pm
- Localisation: très précise, merci google
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité